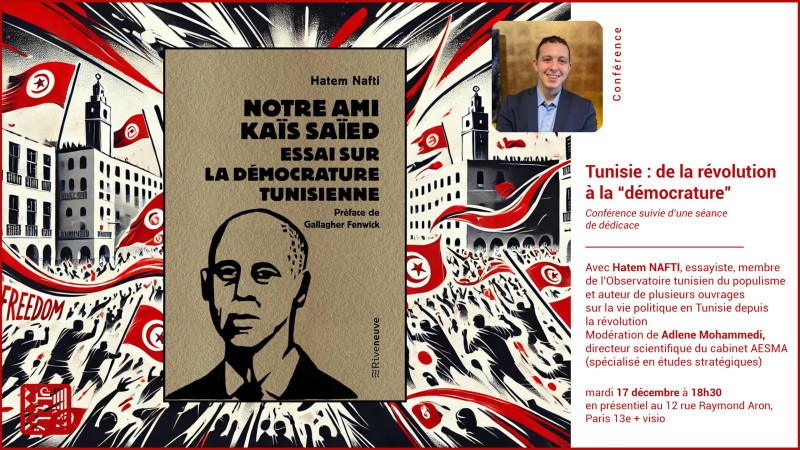Dans une ambiance solennelle et studieuse, le Palais des Sciences de Monastir a récemment accueilli un événement d’une importance capitale pour la région : le congrès régional pour la préparation, la formation et la mobilisation face aux catastrophes et aux crises. Sous la houlette du gouverneur de Monastir, Aïssa Moussa, cette rencontre a réuni des acteurs institutionnels, des experts, des représentants de la société civile et des volontaires, tous animés par une volonté commune : faire de la prévention des risques une priorité et installer durablement la culture du volontariat dans le tissu social local.
Un congrès fondateur pour la prévention et la résilience
Baptisé aussi « congrès fondateur pour le renforcement des capacités en matière de prévention des dangers et des risques », l’événement a marqué une étape décisive dans la stratégie régionale de gestion des catastrophes. Il s’inscrit dans une dynamique nationale qui vise à doter chaque région tunisienne d’outils, de compétences et de réseaux capables de faire face efficacement aux crises, qu’elles soient naturelles ou d’origine humaine.
Les participants ont pu débattre des enjeux majeurs liés à la prévention, à la préparation et à la gestion des situations d’urgence. Au cœur des discussions : l’importance de la formation continue, la nécessité de bâtir des ponts entre les institutions publiques et la société civile, et la mobilisation du plus grand nombre autour de la culture du volontariat. Car, comme l’ont souligné plusieurs intervenants, la résilience d’une région face aux catastrophes dépend autant de la qualité des infrastructures que de l’engagement de ses citoyens.
Le volontariat, pilier de la gestion des crises
À Monastir, la diffusion de la culture du volontariat n’est plus un simple slogan, mais une véritable politique régionale. Le congrès a mis en lumière le rôle central des bénévoles dans toutes les phases de la gestion des risques : de la sensibilisation à la prévention, de l’alerte rapide à la réponse d’urgence, sans oublier la reconstruction post-crise. Les expériences partagées lors des ateliers ont montré que l’action bénévole, structurée et soutenue par les autorités, permet de sauver des vies, de limiter les dégâts et de renforcer le tissu social.
Les initiatives présentées ont également souligné la nécessité de former les volontaires, de leur offrir des outils adaptés et de valoriser leur engagement. Une attention particulière a été portée à l’intégration des jeunes et des femmes dans les dispositifs de prévention et d’intervention, considérés comme des relais essentiels pour ancrer la culture du volontariat dans toutes les composantes de la société.
Des recommandations concrètes pour l’avenir
À l’issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées pour pérenniser et amplifier la dynamique enclenchée à Monastir. Parmi elles :
-
La création de cellules locales de veille et d’intervention rapide, regroupant des volontaires formés et des professionnels.
-
Le développement de programmes de formation réguliers sur la gestion des risques, accessibles à tous les citoyens.
-
La mise en place de campagnes de sensibilisation à grande échelle, en particulier dans les écoles, les universités et les quartiers populaires.
-
Le renforcement de la coopération entre les autorités locales, les ONG, les structures de santé et les services de sécurité civile.
-
L’élaboration d’un plan régional de mobilisation citoyenne, avec des exercices pratiques et des simulations de crise.
Monastir, modèle pour la Tunisie ?
L’expérience de Monastir pourrait bien inspirer d’autres régions du pays. Face à la multiplication des aléas climatiques, des incendies, des inondations ou des crises sanitaires, la Tunisie a plus que jamais besoin d’une société mobilisée, formée et solidaire. En faisant du volontariat un pilier de sa stratégie de gestion des risques, Monastir montre la voie vers une nouvelle gouvernance des crises, plus inclusive et plus efficace.
Ce congrès régional aura donc été bien plus qu’un simple rendez-vous institutionnel : il aura posé les bases d’une culture de la prévention et de la solidarité, où chaque citoyen devient acteur de la sécurité collective. Un pari audacieux, mais nécessaire, pour un avenir plus sûr et plus résilient.